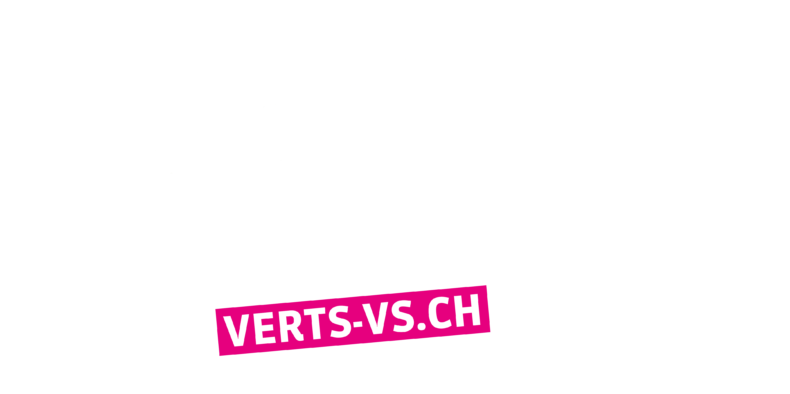De l’empreinte écologique à la sobriété joyeuse : entre action publique et changement de valeurs
Texte de la conférence de Christophe Clivaz donnée le 09.11.2013 au Musée de la nature de Sion dans le cadre de la Nuit des musées

Introduction
Je voudrais pour commencer remercier les organisateurs de m’avoir accordé cette carte blanche. Je me suis dit que c’était l’occasion de prendre un peu de recul et de faire le point sur les raisons de mon engagement dans le débat public. Cet engagement passe par la politique bien sûr mais aussi par mes activités professionnelles (je suis prof. de science politique à l’IUKB et j’enseigne et fais de la recherche dans le domaine de la gouvernance et de l’analyse comparée des politiques touristiques) et associatives (notamment comité FDDM et comité Altitude 1400). Il existe une cohérence entre ces différents types d’engagement (et des synergies heureusement pour mon emploi du temps !).
Contrairement à d’autres politiciens qui sont tombés tout petits dans la marmite politique, je suis arrivé relativement tard en politique. J’ai assez tôt eu un intérêt pour la chose publique, déjà au collège lorsque nous étudions la manière dont différents philosophes voyaient le rôle de l’Etat. J’ai ainsi fait des études de science politique afin d’essayer de comprendre comment fonctionne la société et quel rôle peut jouer l’acteur public dans ce fonctionnement. Concernant mon ancrage partisan, je n’étais pas « écolo » à 20 ans. C’est petit à petit, au cours de mon parcours universitaire, notamment au travers de différents travaux portant sur les relations entre l’activité touristique et l’environnement, que j’ai pris connaissance des répercussions de notre développement économique sur l’écosystème et que ma conscience écologique s’est forgée.
Je suis donc un scientifique qui est venu à la politique en me disant que je devais essayer d’apporter ma pierre à la construction d’un « monde meilleur ». Cet aller-retour entre la science et la politique, que je vis pratiquement au quotidien, n’est pas toujours évident et s’apparente parfois à un exercice d’équilibriste. Je n’ai cependant pour l’instant pas trop l’impression de faire le grand écart ou de souffrir de troubles schizophréniques, le scientifique et le politique ne disant pas, me semble-t-il, des choses trop contradictoires.
L’objectif de ces quelques mots d’introduction était que vous puissiez un peu mieux cerner mon parcours, mais je ne suis pas ici pour vous parler de moi, mais bien de ce qui est annoncé par le titre de mon exposé : « De l’empreinte écologique à la sobriété joyeuse : entre action publique et changement de valeurs ». J’aimerais vous livrer quelques réflexions sur ma perception de l’état de la planète et sur les pistes à envisager pour améliorer la situation.
Dans mon exposé, je vais procéder en 4 temps qui suivent en fait les différents éléments évoqués dans mon titre.
1er temps : L’empreinte écologique
Si vous avez pris le temps de visiter le musée de la nature, vous avez remarqué que l’empreinte écologique sert de fil rouge à la visite. On voit comment au cours des siècles cette empreinte a pris de l’ampleur pour aujourd’hui dépasser la capacité biologique estimée de la planète. Le 20 août dernier nous aurions ainsi dépensé toutes les ressources que la planète met à notre disposition en 2013.
Selon l’OFS, « l’empreinte écologique montre quelle surface écologiquement productive est requise pour qu’une région, un pays ou l’humanité tout entière puisse couvrir ses besoins et neutraliser ses déchets ». Toujours selon l’OFS, l’empreinte écologique de la Suisse est aujourd’hui plus de quatre fois supérieure à sa biocapacité.
L’empreinte écologique considère uniquement une partie de la dimension environnementale. Elle ne tient par ex. pas compte de la perte de biodiversité ou de la pollution due aux métaux lourds. L’empreinte écologique ne doit donc pas être comprise un indicateur complet de l’impact de l’activité de l’homme sur la planète. Il s’agit surtout d’un outil de communication, qui permet de manière intuitive de sensibiliser les gens à l’effet de l’activité humaine sur l’écosystème.
L’empreinte écologique met automatiquement le doigt sur la question de la limite au développement. Cette question doit être posée dans monde obnubilé par la croissance. Il n’est plus possible de poursuivre comme si les ressources naturelles étaient inépuisables. Prenons l’exemple de l’utilisation du sol. C’est un thème sur lequel je m’engage beaucoup dans un contexte politique plutôt difficile. Il s’agit de revoir fondamentalement notre aménagement du territoire. L’acceptation de l’initiative contre les résidences secondaires, puis de la révision de la LAT, marque à ce titre un changement fondamental du cadre légal qu’il s’agira encore de mettre en œuvre, mais ça c’est une autre histoire qui mériterait largement une conférence à elle seule…
La question de la limite a déjà été posée par Malthus au 18ème siècle qui soulignait le problème posé par une population croissante sur une planète finie. Plus récemment, dans les années 1970, les travaux du Club de Rome ont ramené la question des limites dans le début public. Enfin le concept de développement durable (DD), popularisé au Sommet de la terre à Rio en 1992, est devenu aujourd’hui le référentiel de l’action publique dans de nombreux pays, notamment dans les pays dit développés.
En Suisse, rares sont ainsi les politiques publiques qui ne mentionnent pas le DD comme leur cadre de référence, respectivement comme un des objectifs qu’elles sont censées atteindre. On se réfère souvent à la définition du DD donnée par le rapport Brundtland en 1987:
« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. »
tout en oubliant souvent de prendre en compte la suite de la définition, à savoir :
« Deux concepts sont inhérents à cette notion:
- le concept de besoins, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité; et
- l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale imposent sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. »
Il est ainsi important de souligner que les pays pauvres ont bien sûr le droit de se développer et que les limitations doivent s’imposer en priorité aux pays dit développés. D’autant plus que dans les pays pauvres l’empreinte écologique par personne est inférieure à leur biocapacité. D’autre part, la définition du DD du rapport Brundtland mentionne clairement la question de la limite.
Et c’est bien normal car comment la croissance permanente du système économique est-elle en effet possible dans un monde fini? Comme le dit Kenneth Boulding, économiste américain, « celui qui croit à une croissance exponentielle et illimitée dans un monde fini est soit un idiot soit un économiste ».
Au-delà de la boutade, une réponse existe pourtant théoriquement : il s’agit de parvenir à découpler la croissance de la production et des revenus de la croissance de la consommation des ressources. Ici il faut distinguer entre le découplage « relatif » et le découplage « absolu ».
Le découplage relatif signifie que pour chaque unité de richesse produite on a réussi à diminuer les flux de matière et d’énergie nécessaire à sa production, mais ceci peut s’accompagner d’une augmentation globale de la consommation de ressources si la consommation augmente, pensons ne serait-ce qu’à l’augmentation de la population qui automatiquement entraîne une augmentation de la consommation.
Le découplage absolu signifie lui que l’on a réussi à diminuer la consommation totale de matières premières et d’énergie, même en ayant une augmentation de la consommation.
2ème temps : l’action publique
C’est là qu’intervient le 2ème élément de mon exposé, l’action publique, qui se matérialise dans les différentes politiques publiques mises en place par les Etats et les collectivités locales en vue d’assurer un développement compatible avec les limites environnementales de la planète. Pour rester en Suisse, le programme Cités de l’énergie ou le renforcement des prescriptions énergétiques des appareils électroménagers et pour l’électronique de loisirs contribuent ainsi à limiter la consommation énergétique. Si je prends l’exemple de la ville de Sion, des efforts sont faits depuis peu pour investir dans le développement du solaire, valoriser (enfin) la chaleur de l’Usine d’incinération des déchets ou assainir progressivement les bâtiments publics. Il reste bien sûr un potentiel important dans différents domaines où l’action publique est clairement insuffisante pour infléchir le développement actuel, que l’on songe à l’agroalimentaire, au transport aérien ou à la lutte contre l’obsolescence programmée par exemple.
Aujourd’hui, malgré les politiques publiques mises en place jusqu’ici, le découplage entre croissance économique et consommation des ressources n’existe pas dans les faits. Cette idée du découplage se retrouve souvent dans la bouche des responsables politiques et économiques pour justifier la poursuite d’une croissance qui, grâce au progrès technologique, deviendrait compatible avec la disponibilité des ressources naturelles. Ce découplage absolu exigerait un tel effort qu’il paraît impossible d’y parvenir dans un futur raisonnable si l’on prend en compte l’augmentation massive de la population au niveau mondial ainsi que la croissance des revenus dans les pays émergents et l’augmentation de la consommation qui l’accompagne.
Il n’existe donc pas d’autres solutions que de remettre en cause le dogme de la croissance. Ce qui ne veut pas dire que le découplage est une mauvaise idée. Le découplage, à défaut d’être absolu, est absolument nécessaire. Mais il est insuffisant pour parvenir à maintenir notre système économique dans les limites environnementales de la planète.
C’est pour remettre en cause ce dogme de la croissance que Tim Jackson, économiste anglais, propose de parler de « prospérité sans croissance ». Jackson reprend les 3 conceptions différentes de la prospérité proposées par Amartya Sen dans son ouvrage The Living Standard publié en 1984:
a) la prospérité comme opulence : la satisfaction matérielle liée au volume de produits matériels qui sont disponibles à la consommation ;
b) la prospérité comme utilité: notion plus qualitative que l’opulence qui met l’accent sur la dimension symbolique et sociale de la satisfaction lors de l’acte de consommation;
c) la prospérité comme capacités d’épanouissement: santé, espérance de vie et surtout possibilité de participer à la vie de la société, en résumé la capacité de s’épanouir ou « l’émancipation de l’être ».
Pour Jackson, la question fondamentale est la suivante : est-ce que la prospérité, au sens de capacité d’épanouissement des hommes et des femmes, est possible sans croissance ?
Nous sommes en fait face à un dilemme. D’un côté la croissance est non soutenable car elle signifie l’épuisement des ressources naturelles. De l’autre, la décroissance amène une baisse de la consommation et en conséquence un effondrement du système économique, le chômage et une augmentation de la précarité. Cet effondrement s’accompagne donc de désastreuses conséquences sociales dans un système où le maintien du niveau des prestations sociales (retraites, assurance chômage, etc.) présuppose la croissance économique.
Comment sortir de ce dilemme de la croissance ? L’action de l’Etat, via ses différentes politiques publiques, ne parvient pas à modifier fondamentalement le système actuel, par manque de volonté politique certes, mais pas seulement. Se pose selon moi plus fondamentalement la question du « sens de la vie » et l’on arrive au 3ème temps de l’exposé, le nécessaire changement de valeurs.
3ème temps : le changement de valeurs
D’une certaine manière, il s’agit de revenir au bon sens de nos grands-parents qui ne laissaient rien perdre et qui réutilisaient tout ce qui pouvait encore servir. Certes eux n’avaient souvent pas le choix dans une société qui n’était pas encore d’abondance. Aujourd’hui il faut revenir non pas à la bougie, reproche souvent entendu dans les milieux anti-écolo, mais à une société sobre car, comme on l’a vu précédemment, l’innovation technologique comme le renforcement des prescriptions environnementales ne suffiront pas pour répondre aux défis écologiques.
C’est pourquoi un changement de valeurs par rapport à la société de consommation s’impose. Je suis toujours surpris de constater que nos enfants sont de plus en plus sensibilisés aux questions environnementales, par l’intermédiaire notamment de l’école, mais que dans le même temps ils sont bombardés de messages publicitaires leur faisant passer un message simple : « si tu veux être heureux, consomme ! ». Pour sortir de cette position pour le coup proprement schizophrénique, un changement de valeurs est nécessaire. Il faut privilégier l’être au lieu de l’avoir, l’usage plus que la possession (économie de la fonctionnalité), le renoncement volontaire plutôt que la fuite en avant, la lenteur plus que la rapidité, la satisfaction au lieu de l’accumulation.
Comme le dit le philosophe Frédéric Lenoir dans l’HEBDO du 24 oct. dernier, « il faut rééduquer notre désir, s’éloigner du message consumériste véhiculé par la publicité omniprésente qui prétend que les objets nous rendront heureux et que leur possession rendra notre sort enviable. Le bonheur profond vient de l’amitié, de l’amour, de la réalisation de nos aspirations profondes, de la qualité de nos expériences et de nos relations affectives. »
C’est cette attitude que je résume par l’expression de « sobriété joyeuse », 4ème et dernier temps de mon exposé.
4ème temps : la sobriété joyeuse
Le choix aurait pu se porter sur d’autres termes comme « sobriété volontaire » (titre de l’ouvrage dirigé par Dominique Bourg et Philippe Roch, 2012), la « sobriété heureuse » (Pierre Rabhi, 2010), la « décroissance heureuse » (Maurizio Pallante, 2011) ou encore la « décroissance sereine » (Serge Latouche, 2007), etc., autant d’expressions proposées par différents auteurs qui tous remettent fondamentalement en cause le système économique actuel et cherchent des alternatives.
Un élément fondamental pour pouvoir accomplir ce changement de valeurs consiste à ne plus se comparer aux autres : les études montrent que passé un certain niveau de vie matériel, une augmentation de ce dernier n’amène pas un sentiment de bonheur plus élevé. Et pourtant, dans les sociétés d’abondance comme la Suisse, les personnes cherchent souvent à avoir davantage de biens matériels. Ceci s’explique par une logique sociale à la fois d’appartenance et de différenciation qui fait que chacun a tendance à mesurer son bonheur par rapport à la situation des autres. Si votre voisin possède une belle et grande maison avec piscine et plusieurs voitures dans son garage et que vous-même n’avez qu’une maison normale et une petite voiture, votre sentiment de bonheur diminue. C’est une course sans fin… ou plutôt la fin arrive avec l’épuisement progressif des matières premières nécessaires à la fabrication des biens matériels.
En Valais il existe différentes initiatives où des gens se sont lancés dans des modèles alternatifs de vivre ensemble qui correspondent à cette idée de sobriété joyeuse. Par exemple la coopérative Ozechange à Martigny, qui se définit comme lieu de partage, d’échange, de formation et d’information qui développe différents projets et manifestations comme des ateliers sur l’alimentation, des projections de film, etc. On peut aussi mentionner à Sion le café Etiks – Centre d’actions citoyennes qui a lancé différentes initiatives. Par ex. le S.E.L. ou système d’échange local qui est un moyen qui permet d’échanger des services, des biens et des savoirs sans avoir besoin d’argent. Ou les « incroyables comestibles », des bacs de légumes posés en ville qui nous interrogent sur notre rapport à la terre et à l’alimentation.
Ces initiatives concrètes au niveau local permettent de mettre en œuvre l’adage « penser global, agir local ». Elles constituent le terreau sur lequel bâtir la société de demain et leur développement est crucial si l’on veut voir émerger la transition vers un monde évoluant dans les limites de son écosystème.
Conclusion
En conclusion, notre avenir passe à la fois par des choix collectifs, encadrés et mis en musique par les pouvoirs publics, et des choix individuels reposant sur un changement de valeurs. C’est un message qui nous est aussi suggéré dans ce musée, notamment dans les témoignages vidéo du premier étage. Chacun, chacune d’entre nous a la possibilité d’apporter sa contribution à l’émergence d’une société qui s’appuient sur d’autre valeurs que celles véhiculées par la société de consommation, une société qui privilégie l’être à l’avoir (slogan de ma campagne au Conseil d’Etat), une société qui privilégie le partage au gaspillage (slogan de ma campagne de 2007 au Conseil des Etats). Ce qui compte n’est-ce pas la possibilité de nous épanouir : être en sécurité, avoir des moyens de subsistance suffisants bien sûr, mais aussi se sentir partie prenante de la communauté et pouvoir développer son potentiel individuel d’être humain.
Pour parvenir à la fois à ce changement de valeurs et à un cadre d’action publique plus à même de réorienter le système actuel, le chemin est étroit mais je fais mienne cette phrase attribuée à Antonio Gramsci : « pessimisme de la raison, optimisme de la volonté ». Pessimisme du scientifique qui se dit que comme c’est parti ça va franchement être difficile d’éviter toute une série de catastrophes écologiques et sociales ce prochain siècle, optimiste du politicien qui, lui, espère toujours une transition rapide vers un monde décarboné évoluant dans les limites de sa biocapacité et réduisant les conflits pour l’accès aux ressources naturelles. Cette fois je commence à devenir vraiment schizophrénique, il est temps d’arrêter là…